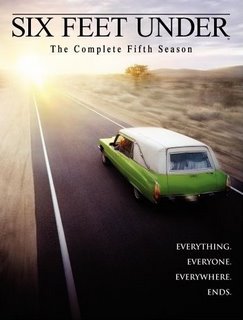Les malheurs de Sofia

Bon, il va falloir que j'arrête de parler des sornettes débitées par les filles et fils à papa (ou maman). Ou alors leur consacrer un blog. Et Dieu sait qu'il y a matière à le faire.
 Mais là, vraiment, on atteint des sommets dans la bêtise. Notre enfant gâté de la semaine s'appelle Sofia Coppola. Son dernier film, qu'elle a écrit et réalisé, Marie-Antoinette, est sorti il y a peu sur les écrans. Après un accueil houleux à Cannes et une critique plus que divisée aujourd'hui, notre princesse Siddharta ne s'en répand pas moins dans les journaux en déclarations lénifiantes.
Mais là, vraiment, on atteint des sommets dans la bêtise. Notre enfant gâté de la semaine s'appelle Sofia Coppola. Son dernier film, qu'elle a écrit et réalisé, Marie-Antoinette, est sorti il y a peu sur les écrans. Après un accueil houleux à Cannes et une critique plus que divisée aujourd'hui, notre princesse Siddharta ne s'en répand pas moins dans les journaux en déclarations lénifiantes.
La dernière ? Elle vient d'affirmer qu'elle ne pourrait jamais laisser quelqu'un d'autre réaliser l'un de ses scénarios, expliquant :
Pauvre, pauvre petite fille riche ! La vie n'a pas été tendre avec elle.
Petite-fille de Carmine Coppola, compositeur de musiques de films, fille de Francis Ford Coppola, auteur-réalisateur talentueux. A vingt-huit ans, elle se retrouve à la barre d'un premier long-métrage, Virgin Suicides. Quand on sait que le producteur dudit film est son pôpa chéri, on s'imagine le calvaire que ça a été pour elle de monter le projet et d'embaucher Kathleen Turner, Scott Glenn et Danny de Vito. Mais déjà Sofia perçait sous Coppola. Car le titre original complet du film est Sofia Coppola's Virgin Suicides. La modestie incarnée…
Le plus dur pour la fille Coppola, pour écrire et réaliser un film ? Euh… Imaginer une bonne histoire ? Non, vous n'y êtes pas. Pour ça, c'est facile. Il suffit de prendre un roman tragique contemporain, Virgin Suicides de Jeffrey Eugenides, et d'en faire une adaptation. Et le tour est joué. Parce que, évidemment, comme chacun sait, c'est facile d'adapter un livre, yaka filmer ce que dit le texte. Ben voyons !
Résultat des courses : le film n'est pas déplaisant – faut quand même lui rendre justice –, mais le bouquin y est quand même pour beaucoup. Et le film porte les stigmates d'une réalisatrice débutante :
- le rythme lancinant du film est voulu, mais le montage n'est clairement pas assez serré;
- la direction d'acteurs laisse franchement à désirer;
- la voix off est omniprésente. Et ça, quand on ne sait pas la maîtriser, ça plombe rapidement un film. Tout le monde n'a pas le talent de David Fincher et de son scénariste Jim Uhls lorsqu'ils convertissent brillamment la narration de Chuck Palahniuk dans l'adaptation cinématographique de Fight Club ;
- les flashbacks sont un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Raté, Sofia, t'as mis le pied dedans !
Mais bon, c'est pas grave, Miss Sofia a fait son long-métrage et il est forcément super-réussi. Merci encore les critiques, pour votre dégoulinante hypocrisie.
On ne va donc pas s'arrêter là et la belle poursuit avec un second long-métrage que tout le monde a trouvé (forcément !) excellent : Lost in Translation. À l'arrivée, même constat : pas foncièrement mauvais mais bon, ça casse vraiment pas trois pattes à un canard. Et quand on en est rendu à dire d'un film qu'il est très bien interprété, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à en dire d'autre…
Mais c'est toujours pas grave : same player shoot again. Un troisième long-métrage : Marie-Antoinette. Mais là, la fifille sort du registre consensuel du road-movie triste et elle se prend une claque. Comme si une partie de la critique avait enfin vu (ou oser dire) que, de talent chez Sofia Coppola, il n'y en a point.
C'est encore pas grave, la jeune maman nous pondra un quatrième film dans pas longtemps. Mais bien sûr, que Sofia Coppola puisse continuer à sortir des machins cinématographiques, ça n'a rien à voir avec la personnalité de son papa.
Tout ça pour en revenir à sa fameuse récente déclaration dans laquelle elle expliquait sans rire, qu'elle ne pourrait jamais laisser un autre réalisateur toucher à un de ses scénarios, parce qu'il n'en serait pas digne. Son deuxième prénom n'est certes pas Modestie, mais elle porte surtout mal son premier prénom.
Vous vous souvenez de Spike Jonze ? En 1999 et 2002, il réalise ses deux premiers longs-métrages (Dans la peau de John Malkovich et Adaptation). Depuis cette date, sa carrière cinématographique est au point mort (il est en train de tourner un film qui sortira - peut-être - en 2008 !). Pourquoi cette période de galère après une percée aussi notable dans le panier de crabe hollywoodien ? Tiens, c'est bizarre : entre 1999 et 2003, Spike Jonze avait pour beau-papa un certain... Francis Ford Coppola. Et sa femme était... Oui oui, c'était bien elle. Mais depuis que Jonze a divorcé de la petite princesse italo-américaine, calme plat. Y aurait-il un rapport de cause à effet ? Non, impossible, les gens ne sont pas comme ça…
Sofia, elle s'en fout. Elle ne voit rien de tout ça. Dans sa tour d'ivoire, elle observe le monde à travers le prisme déformant de sa famille dorée sur tranche. Tu parles, Sofia ! Tu peux te permettre, toi, d'écrire des daubes et de les réaliser toi-même ! Y aura toujours papa derrière. Mais t'as pensé aux scénaristes et aux réalisateurs de talent qui galèrent depuis des années et qui ne percent pas dans ce métier parce que leur bonne fée maternelle ou paternelle ne s'est pas penchée sur leur berceau ?
Marie-Antoinette n'a rien vu venir et ne comprend rien au tumulte qui secoue la France en 1789. En 2006, Sofia Coppola, elle, ignore tout des affres de son métier et balance aux journalistes des phrases d'enfant gâtée. Elle pourrait aussi bien leur dire : «Marie-Antoinette, c'est moi.»
 Mais là, vraiment, on atteint des sommets dans la bêtise. Notre enfant gâté de la semaine s'appelle Sofia Coppola. Son dernier film, qu'elle a écrit et réalisé, Marie-Antoinette, est sorti il y a peu sur les écrans. Après un accueil houleux à Cannes et une critique plus que divisée aujourd'hui, notre princesse Siddharta ne s'en répand pas moins dans les journaux en déclarations lénifiantes.
Mais là, vraiment, on atteint des sommets dans la bêtise. Notre enfant gâté de la semaine s'appelle Sofia Coppola. Son dernier film, qu'elle a écrit et réalisé, Marie-Antoinette, est sorti il y a peu sur les écrans. Après un accueil houleux à Cannes et une critique plus que divisée aujourd'hui, notre princesse Siddharta ne s'en répand pas moins dans les journaux en déclarations lénifiantes.La dernière ? Elle vient d'affirmer qu'elle ne pourrait jamais laisser quelqu'un d'autre réaliser l'un de ses scénarios, expliquant :
J'aurais peur qu'il ne réussisse pas à lui rendre justice.
Pauvre, pauvre petite fille riche ! La vie n'a pas été tendre avec elle.
Petite-fille de Carmine Coppola, compositeur de musiques de films, fille de Francis Ford Coppola, auteur-réalisateur talentueux. A vingt-huit ans, elle se retrouve à la barre d'un premier long-métrage, Virgin Suicides. Quand on sait que le producteur dudit film est son pôpa chéri, on s'imagine le calvaire que ça a été pour elle de monter le projet et d'embaucher Kathleen Turner, Scott Glenn et Danny de Vito. Mais déjà Sofia perçait sous Coppola. Car le titre original complet du film est Sofia Coppola's Virgin Suicides. La modestie incarnée…
Le plus dur pour la fille Coppola, pour écrire et réaliser un film ? Euh… Imaginer une bonne histoire ? Non, vous n'y êtes pas. Pour ça, c'est facile. Il suffit de prendre un roman tragique contemporain, Virgin Suicides de Jeffrey Eugenides, et d'en faire une adaptation. Et le tour est joué. Parce que, évidemment, comme chacun sait, c'est facile d'adapter un livre, yaka filmer ce que dit le texte. Ben voyons !
Résultat des courses : le film n'est pas déplaisant – faut quand même lui rendre justice –, mais le bouquin y est quand même pour beaucoup. Et le film porte les stigmates d'une réalisatrice débutante :
- le rythme lancinant du film est voulu, mais le montage n'est clairement pas assez serré;
- la direction d'acteurs laisse franchement à désirer;
- la voix off est omniprésente. Et ça, quand on ne sait pas la maîtriser, ça plombe rapidement un film. Tout le monde n'a pas le talent de David Fincher et de son scénariste Jim Uhls lorsqu'ils convertissent brillamment la narration de Chuck Palahniuk dans l'adaptation cinématographique de Fight Club ;
- les flashbacks sont un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Raté, Sofia, t'as mis le pied dedans !
Mais bon, c'est pas grave, Miss Sofia a fait son long-métrage et il est forcément super-réussi. Merci encore les critiques, pour votre dégoulinante hypocrisie.
On ne va donc pas s'arrêter là et la belle poursuit avec un second long-métrage que tout le monde a trouvé (forcément !) excellent : Lost in Translation. À l'arrivée, même constat : pas foncièrement mauvais mais bon, ça casse vraiment pas trois pattes à un canard. Et quand on en est rendu à dire d'un film qu'il est très bien interprété, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à en dire d'autre…
Mais c'est toujours pas grave : same player shoot again. Un troisième long-métrage : Marie-Antoinette. Mais là, la fifille sort du registre consensuel du road-movie triste et elle se prend une claque. Comme si une partie de la critique avait enfin vu (ou oser dire) que, de talent chez Sofia Coppola, il n'y en a point.
C'est encore pas grave, la jeune maman nous pondra un quatrième film dans pas longtemps. Mais bien sûr, que Sofia Coppola puisse continuer à sortir des machins cinématographiques, ça n'a rien à voir avec la personnalité de son papa.
Tout ça pour en revenir à sa fameuse récente déclaration dans laquelle elle expliquait sans rire, qu'elle ne pourrait jamais laisser un autre réalisateur toucher à un de ses scénarios, parce qu'il n'en serait pas digne. Son deuxième prénom n'est certes pas Modestie, mais elle porte surtout mal son premier prénom.
Vous vous souvenez de Spike Jonze ? En 1999 et 2002, il réalise ses deux premiers longs-métrages (Dans la peau de John Malkovich et Adaptation). Depuis cette date, sa carrière cinématographique est au point mort (il est en train de tourner un film qui sortira - peut-être - en 2008 !). Pourquoi cette période de galère après une percée aussi notable dans le panier de crabe hollywoodien ? Tiens, c'est bizarre : entre 1999 et 2003, Spike Jonze avait pour beau-papa un certain... Francis Ford Coppola. Et sa femme était... Oui oui, c'était bien elle. Mais depuis que Jonze a divorcé de la petite princesse italo-américaine, calme plat. Y aurait-il un rapport de cause à effet ? Non, impossible, les gens ne sont pas comme ça…
Sofia, elle s'en fout. Elle ne voit rien de tout ça. Dans sa tour d'ivoire, elle observe le monde à travers le prisme déformant de sa famille dorée sur tranche. Tu parles, Sofia ! Tu peux te permettre, toi, d'écrire des daubes et de les réaliser toi-même ! Y aura toujours papa derrière. Mais t'as pensé aux scénaristes et aux réalisateurs de talent qui galèrent depuis des années et qui ne percent pas dans ce métier parce que leur bonne fée maternelle ou paternelle ne s'est pas penchée sur leur berceau ?
Marie-Antoinette n'a rien vu venir et ne comprend rien au tumulte qui secoue la France en 1789. En 2006, Sofia Coppola, elle, ignore tout des affres de son métier et balance aux journalistes des phrases d'enfant gâtée. Elle pourrait aussi bien leur dire : «Marie-Antoinette, c'est moi.»
Lisez la suite...